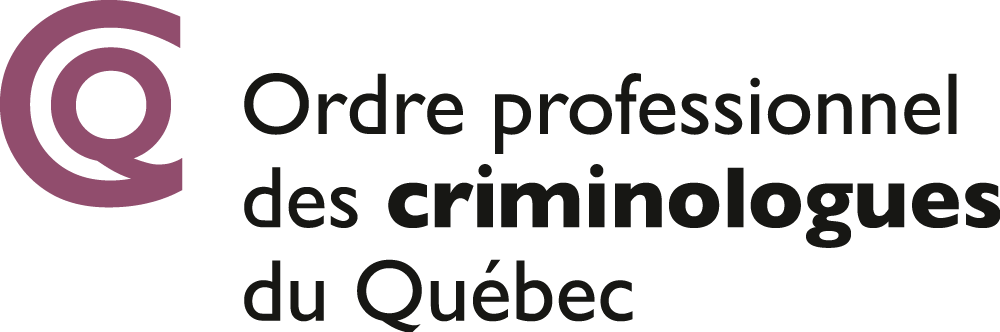Le sujet de cette nouvelle édition du Beccaria m’interpelle personnellement et je souhaitais sincèrement contribuer à celle-ci en tant que criminologue, mais aussi, et surtout, en tant que personne. C’est souvent ce que les personnes du milieu de l’intervention ont tendance à oublier. Ils sont leur propre outil de travail.
Il y a un être humain derrière chaque criminologue. Il faut donc prendre soin de cet humain si nous souhaitons poursuivre une longue carrière dans le domaine de l’intervention.
Qui suis-je pour parler de cela ? Criminologue graduée en 2002, j’ai débuté ma carrière auprès des ex-détenus en maison de transition. Ce milieu difficile et non volontaire n’était finalement pas fait pour moi et c’est en 2004 que l’intervention auprès des personnes victimes s’est avérée être ce qui me passionnerait pour le reste de ma carrière. Je me rappelle la jeune criminologue de l’époque. Nouvellement en poste au CAVAC de Montréal, on voit en moi une femme fonceuse qui ne craint pas les défis. On me confie donc de beaux projets qui me stimulent. Je ne perçois pas que dans ce tourbillon, j’oublie de prendre soin de moi. En 2006, un terrible dossier d’agression sexuelle sur une enfant de 4 ans viendra me faire réaliser que je suis faillible. J’ai développé un trauma vicariant. Anxiété, crise de panique, remise en question pour ne nommer que celles-ci ont fait partie dema vie pendant l’année qui a suivi. J’ai été chercher de l’aide psychologique, mais je n’ai jamais arrêté de travailler. « Ce n’est pas vrai qu’à 26 ans, en début de carrière, j’allais mettre un genou par terre et dire que je n’allais pas bien. Comment cela aurait-il été perçu ? ». Voilà un discours que j’entends encore trop souvent malheureusement.
J’ai donc poursuivi ma carrière, avec cette expérience que je ne souhaite à personne, en ayant en tête que je serais désormais plus alerte aux signaux. Ces derniers peuvent être parfois très subtils; une plus grande fatigue, augmentation de l’anxiété, une perte de motivation dans différentes sphères de vie, pas nécessairement en lien avec le travail, irritabilité et grand sentiment d’impuissance pour ne nommer que ceux-ci. Ainsi, quand je détectais certains signaux, je mettais tout en œuvre pour éviter de sombrer de nouveau. Tout d’abord, je prenais le temps de me regarder et de déterminer ce dont j’avais besoin à ce moment. Parfois, pratiquer du sport, aller en nature ou voir des amies me suffisait. D’autre fois, je choisissais par exemple de changer de poste temporairement pour un poste moins axé sur l’intervention ou je retournais consulter en psychologie.
En 2011, j’ai débuté un très beau poste d’intervenante du CAVAC aux crimes majeurs du SPVM. Mon poste de rêve ! Travailler sur l’adrénaline tous les jours, sur des dossiers d’envergure, avec des enquêteurs de renom. Chaque journée avait ses défis à relever et tout autant de charges émotives à gérer; rencontrer une personne qui a été victime d’agression sexuelle durant la nuit et en après-midi, une maman qui a perdu son fils sous les balles. Mon Dieu que j’étais stimulée… mais tellement seule pour gérer cette charge. En 2019, j’ai atteint mon quota d’horreur. Par réflexe de protection, j’avais l’impression que je ne me laissais plus toucher par la majorité des histoires que j’entendais et parfois, j’avais l’impression de répéter une cassette dans mes interventions. C’est ce dernier point qui m’a particulièrement alerté. Les gens que je rencontrais avaient besoin d’un humain devant eux et non pas d’un robot. Je ressentais que je devais aller le plus loin possible de l’intervention de crise. Après un an de pause, dans un autre domaine connexe, le contexte des personnes victimes me manquait. Je suis donc revenue comme coordonnatrice clinique au CAVAC de Montréal. C’est là que j’ai constaté, en certains jeunes intervenants, plusieurs signaux d’alarme à considérer afin de s’assurer de prendre soin d’eux. J’ai décidé de faire du trauma vicariant et de la fatigue de compassion mon cheval de bataille.
Dans la société actuelle, il y a une tendance à la performance, toujours être le meilleur, ne pas faillir. C’est ce que les réseaux sociaux nous montrent également. J’ai eu la chance de superviser plusieurs stagiaires en criminologie dans les dernières années. J’ai constaté que la compétition est ÉNORME sur les bancs de l’université. Les étudiants sont constamment sous pression et plusieurs vont développer des symptômes d’anxiété. Alors imaginons ces jeunes criminologues fraichement gradués dans un milieu plus dur, dans lequel il leur est difficile de nommer leur détresse. Cela ne fait pas bon ménage… À l’inverse, je constate tout de même une plus grande sensibilisation chez nos jeunes intervenants quant au trauma vicariant. Ils ont eu la chance d’en entendre parler à l’université. Heureusement, de plus en plus n’hésiterons pas à consulter un superviseur, le programme d’aide aux employés et même à prendre un arrêt de travail. À mon époque, les arrêts de travail étaient extrêmement rares. Ce changement me paraît très positif, mais ces nombreux arrêts de travail sont tout de même inquiétants.
Est-ce que les intervenants sont assez outillés pour prendre soin d’eux ? Devrions-nous inclure un cours à ce sujet dans les cursus universitaires ?
Par cet article, j’ai envie d’envoyer un message aux jeunes criminologues qui débutent dans le domaine. Le travail de criminologue est un très beau métier, il est possible de faire une belle et longue carrière, mais il peut parfois être difficile. Il est donc tout aussi important d’apprendre comment prendre soin de soi que d’apprendre les bonnes techniques d’intervention. N’hésitez jamais à prendre un pas de recul, de vous questionner sur votre ressenti, à demander de l’aide et de vous prioriser.
Surtout, prenez soin de vous !