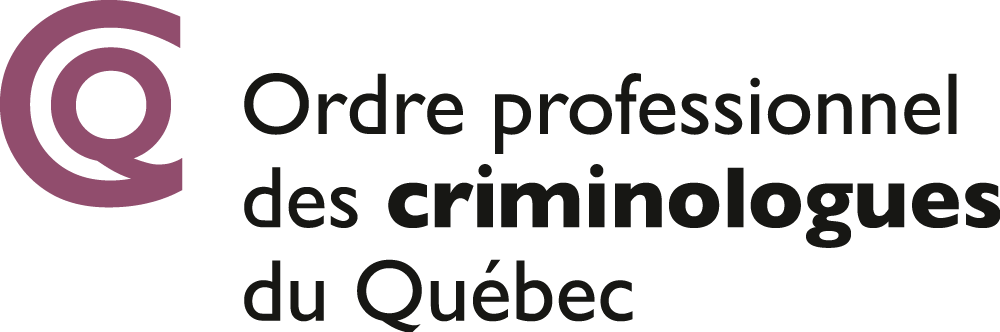Les criminologues qui travaillent directement dans les milieux de pratique sont régulièrement confronté(e) s à des expériences potentiellement traumatisantes. Toutes les populations identifiées dans les actes professionnels réservés aux criminologues souffrent aussi disproportionnellement d’exposition à des traumatismes1-7. Les objectifs de prévention, de réadaptation et de réintégration des interventions criminologiques doivent être atteints « tout en protégeant les droits des individus et de la collectivité »8. Cependant certaines de ces interventions ont un potentiel traumatique élevé et peuvent entraîner un stress post-traumatique à la fois pour les client(e) s et à la fois pour les criminologues9,10.
Ces préjudices potentiels auxquels sont confrontés les criminologues sont moins évidents dans la formation, les activités professionnelles, les politiques et les pratiques organisationnelles les impliquant.
Néanmoins c’est le soi du criminologue qui permet l’intervention et à travers lequel les clients peuvent vivre une relation d’aide.
Par conséquent, le bien-être individuel d’un criminologue peut être lié au succès de ses interventions.
Les progrès scientifiques examinant les impacts de divers vecteurs de traumatismes interpersonnels et systémiques, associés à des pénuries de main-d’œuvre dans les systèmes de services sociaux à l’échelle internationale, ont mis en évidence l’importance du bien-être professionnel.
L’exposition au trauma peut affecter la qualité de vie et le fonctionnement global des professionnels, jusqu’à conduire à de sérieux problèmes de santé dans les cas extrêmes.
Au travail, cela peut se traduire par un jugement professionnel altéré11 ou encore par une diminution des capacités de régulation émotionnelle, pourtant nécessaires à l’exécution de la majorité des interventions. Ces défis peuvent également contribuer au roulement de personnel, créant un manque de stabilité des services12 qui s’est avérée avoir un impact négatif sur la clientèle. Par exemple, il a été démontré que le roulement du personnel contribue à des trajectoires plus difficiles pour les jeunes placés en centre de réadaptation sous la responsabilité de la DPJ13; et qu’il augmente également les coûts d’exploitation pour les systèmes de services sociaux à travers plusieurs secteurs14.
La manière dont les préjudices peuvent se manifester est très personnelle et changeante d’une personne à une autre. Cela dit, plusieurs phénomènes liés au trauma sont apparus comme potentiellementrisqués pour les professionnels de la relation d’aide en général. Cela inclut notamment le trouble de stress post-traumatique (TSPT) qui peut survenir par l’expérience directe d’un événement traumatique ou par l’exposition aux détails aversifs des événements traumatiques vécus par autrui. Ce dernier type de TSPT a d’abord été identifié comme un trauma vicariant, une fatigue de compassion, ou un stress traumatique secondaire, avant d’être formellement inclus dans les critères de diagnostic du TSPT en 201315. La méconnaissance de cette information peut d’ailleurs mener à des diagnostics erronés d’épuisement professionnel. Les criminologues sont aussi confrontés à cette problématique, mais elle n’est ni liée au trauma, ni spécifique aux professions d’aide. Aussi, le trauma complexe, qui peut prêter à confusion en raison de ses deux définitions distinctes, est une autre forme de trauma à laquelle les criminologues sont exposés. Décrit parfois comme des expériences traumatiques vécues dans des périodes de développement sensibles dans l’enfance16, le trauma complexe est aussi défini comme s’appliquant aux adultes exposés à un traitement répétitif et menaçant au fil du temps17. Comme le diagnostic de TSPT utilisé en Amérique du Nord a maintenant identifié cette exposition répétitive, nous pouvons identifier le trauma complexe chez l’adulte à travers le large prisme du TSPT15.
Un autre préjudice possible du travail dans les services sociaux est la détresse morale. Il s’agit du nom donné à l’angoisse qu’un professionnel peut ressentir lorsqu’il doit faire des choses à, pour ou avec des clients qu’il croit faire souffrir inutilement. La détresse morale suscite un intérêt considérable, car elle a été directement liée à une altération fonctionnelle et à un roulement parmi les prestataires de soins de santé18. Il convient également de noter que les professionnels peuvent ne pas présenter tous les critères pour un diagnostic de TSPT et que la détresse morale n’est pas du tout un diagnostic formel, mais cela ne suggère pas que leur souffrance est négligeable ; d’ailleurs, dans de tels cas, ils peuvent recevoir d’autres diagnostics (telles qu’un trouble de l’adaptation, épuisement professionnel, dépression ou anxiété) s’ils cherchent de l’aide médicale ou souhaitent faire une demande d’invalidité.
De nombreuses recherches ont été menées pour mieux comprendre ce qui conduit aux préjudices subis par les professionnels de la relation d’aide et ce qui conduit les personnes à démissionner de ce type de postes. Les facteurs au travail examinés incluent la violence, l’autonomie de décision ou l’inclusion, les exigences, l’autosoins, la charge, l’ambiguïté ou le conflit de rôle, l’engagement organisationnel, l’épuisement professionnel, les attitudes liées au trauma, le stress traumatique secondaire, l’engagement affectif, la satisfaction à l’égard de la supervision, la détresse morale, les salaires, le soutien social ainsi que les facteurs liés à la personnalité et à l’adversité vécue à l’enfance19-26. Ce qui semble être à l’origine des dommages liés au travail et au roulement de personnel est donc une interaction complexe de facteurs individuels, locaux et systémiques. De même, les recherches qui étudient les facteurs favorisant la résilience ont montré qu’il n’existe pas de facteurs uniques ou de groupes de facteurs spécifiques permettant de la prédire27.
La rhétorique populaire suggère l’autosoins comme un facteur protecteur ; cependant, il existe peu de preuves soutenant que les stratégies d’autosoins (« self-care ») soient efficaces sans une culture organisationnelle et un leadership pour soutenir de tels efforts28. Le debriefing en une seule séance après des incidents critiques a été mis en place dans de nombreux contextes, mais n’a pas démontré son efficacité. Dans certaines circonstances, il peut même être nocif29. Une approche réactive, en particulier celle ciblant les préjudices au niveau individuel, ne semble pas non plus efficace selon les preuves empiriques. Par exemple, une fois qu’une personne est diagnostiquée avec un TSPT, le processus de guérison peut être très coûteux et prendre beaucoup de temps30. Un changement philosophique qui vise plus large que les approches individualisées et réactives, par exemple avec ce que l’on appelle les approches sensibles aux traumas (AST), commence donc maintenant à gagner du terrain.
Les AST ont évolué en réaction aux besoins des personnes ayant vécu des traumas interpersonnels ou systémiques. Elles représentent une restructuration majeure dans la manière dont les services sociaux sont conçus et fournis, soulignant la nécessité de changer les systèmes à tous les niveaux pour toutes les parties prenantes : le bien-être des clients, de leurs familles et communautés, mais aussi celui du personnel. Les pratiques et politiques doivent ainsi être transparentes, cohérentes, culturellement pertinentes et significatives, informées par les besoins et l’expertise locaux. Les AST sont délivrés à travers les structures sociales existantes, tirant parti de l’un des facteurs les plus protecteurs contre le trauma : le soutien social. Plusieurs modèles ont été testés et des preuves commencent à émerger démontrant leur efficacité dans la réduction des symptômes de santé mentale parmi des populations diverses31-37. Bien que beaucoup reste à comprendre concernant cette nouvelle manière de percevoir l’adversité et la résilience humaine, jusqu’à présent, les AST ne semblent pas présenter d’effets néfastes.
Les personnes impliquées dans les services criminologiques, qui ont été judiciarisées, victimisées, et celles qui travaillent au sein du système, ont besoin des recours contre les effets néfastes des expériences traumatisantes38-45. Comme tel, notre système est très coûteux et peu efficace. Nos ressources seraient mieux investies à comprendre les impacts du trauma sur toutes les parties prenantes et à transformer nos services et nos milieux de travail en moteurs de bien-être.46-50. Les impacts du trauma sont ressentis collectivement et doivent être reconnus collectivement afin de prendre soin de ceux qui sont à risque et d’arrêter la perpétuation des cycles de préjudices.
L’auteur souhaite remercier Sabrina Bourget pour sa révision et édition linguistique inestimables.
Références
1 Struck, N., et al., Childhood maltreatment and adult mental disorders – the prevalence of different types of maltreatment and associations with age of onset and severity of symptoms. Psychiatry Research, 2020. 293.
2 Angelakis, I., J. Austin, and P. Gooding, Association of Childhood Maltreatment With Suicide Behaviors Among Young People : A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Network Open, 2020. 3(8) : p. e2012563-e2012563.
3 Baglivio, M., et al., The prevalence of adverse childhood experiences (ACE) in the lives of juvenile offenders. Journal of Juvenile Justice, 2014. 3(2) : p. 1-23.
4 Jondec, A. and J. Barlow, An intensive perinatal mentalisation-based intervention for women at risk of child removal and the role of restorative relationships. Child Abuse Review, 2023. 32(1) : p. e2801.
5 Commission de vérité et réconciliation du Canada, Les survivants s’expriment : un rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. 2015, Commission de vérité et réconciliation du Canada : [Winnipeg].
6 Wesley-Esquimaux, C., M. Smolewski, and Aboriginal Healing Foundation, Historic trauma and aboriginal healing. The Aboriginal Healing Foundation Research series. 2004, Ottawa : Aboriginal Healing Foundation.
7 Heath, L., J. Torrie, and K. Gill, Mental Health in the Cree Peoples of Northern Quebec : Relationships Among Trauma, Familial Psychological Distress, and Mood or Anxiety Disorders. The Canadian Journal of Psychiatry, 2019. 64(3) : p. 180-189.
8 Québec, O.p.d.c.d. Qu’est-ce qu’un criminologue ? 2024 [cited 2024; Available from : https ://ordrecrim.ca/public/protection-public/quest-ce-quun-criminologue/.
9 Mohr, W., T. Petti, and B. Mohr, Adverse effects associated with physical restraint. The Canadian Journal of Psychiatry, 2003. 48(5) : p. 330-337.
10 Kersting, X., S. Hirsch, and T. Steinert, Physical Harm and Death in the Context of Coercive Measures in Psychiatric Patients : A Systematic Review. Frontiers in psychiatry, 2019. 10 : p. 400.
11 Regehr, C., et al., The influence of clinicians’ previous trauma exposure on their assessment of child abuse risk. The Journal of Nervous and Mental Disease, 2010. 198 : p. 614-618.
12 Middleton, J. and C. Potter, Relationship between vicarious traumatization and turnover among child welfare professionals. Journal of Public Child Welfare, 2015. 9(2) : p. 195-216.
13 Hébert, S., N. Lanctôt, and M. Turcotte, “I didn’t want to be moved there” : Young women remembering their perceived sense of Agency in the Context of placement instability. Children and Youth Services Review, 2016. 70 : p. 229-237.
14 Wells, J., et al., A Model of Turnover Intent and Turnover Behavior Among Staff in Juvenile Corrections. Criminal Justice and Behavior, 2016. 43(11) : p. 1558-1579.
15 American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.). 2022, Washington, DC : American Psychiatric Association
16 Cook, A., et al., Complex trauma in children and adolescents. Psychiatric Annals, 2005. 35(5) : p. 390-398.
17 World Health Organization [WHO], Complex post traumatic stress disorder, in International Classification of Diseases, Eleventh Revision [ICD-11]. 2019/2021.
18 Austin, C., R. Saylor, and P. Finley, Moral distress in physicians and nurses : Impact on professional quality of life and turnover. Psychological Trauma : Theory, Research, Practice, and Policy, 2017. 9(4) : p. 399-406.
19 Kim, H. and D. Kao, A meta-analysis of turnover intention predictors among U.S. child welfare workers. Children and Youth Services Review, 2014. 47 : p. 214-223.
20 Wells, J.B., et al., A Model of Turnover Intent and Turnover Behavior Among Staff in Juvenile Corrections. Criminal Justice and Behavior, 2016. 43(11) : p. 1558-1579.
21 Hollinshead, D. and R. Orsi, Developing an Ecological Model of Turnover Intent : Associations Among Child Welfare Caseworkers’ Characteristics, Lived Experience, Professional Attitudes, Agency Culture, and Proclivity to Leave. International Journal on Child Maltreatment : Research, Policy and Practice, 2023 : p. 1-27.
22 Olaniyan, O., et al., Lean on me : A scoping review of the essence of workplace support among child welfare workers. Frontiers in psychology, 2020. 11 : p. 287.
23 Lamothe, J., et al., Violence against child protection workers : A study of workers’ experiences, attributions, and coping strategies. Child Abuse & Neglect, 2018. 81 : p. 308-321.
24 Alward, L.M. and J. Viglione, Individual Characteristics and Organizational Attributes : An Assessment of Probation Officer Burnout and Turnover Intent. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 2023.
25 Wood, L., et al., Turnover Intention and Job Satisfaction Among the Intimate Partner Violence and Sexual Assault Workforce. Violence and Victims, 2019. 34(4) : p. 678-700.
26 Brend, D., M. Herttalampi, and M. Mänttäri-van der Kuip, Brief report : Burnout and moral distress among social workers working with children and families versus those who do not. International Journal of Child and Adolescent Resilience, 2023. 10(1) : p. https ://www.ijcar-rirea.ca/index. php/ijcar-rirea/article/view/327/293.
27 Bonanno, G., The resilience paradox. European Journal of Psychotraumatology, 2021. 12(1) : p. 1942642.
28 Strolin-Goltzman, J., et al., Moving beyond self-care : Exploring the protective influence of interprofessional collaboration, leadership, and competency on secondary traumatic stress. Traumatology, 2020 : p. No Pagination Specified.
29 Rose, S.C., et al., Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2002(2).
30 Forbes, D., et al., Effective Treatments for PTSD : Practice Guidelines from the International Society for Traumatic Stress Studies. 2020, New York, UNITED STATES : Guilford Publications.
31 Han, H., et al., Trauma informed interventions : A systematic review. PLoS One, 2021. 16(6) : p. e0252747.
32 Rivard, J., et al., Preliminary results of a study examining the implementation and effects of a trauma recovery framework for youths in residential treatment. Therapeutic Community : The International Journal for Therapeutic and Supportive Organizations, 2005. 26(1) : p. 83-96.
33 Cloitre, M., et al., A developmental approach to complex PTSD : Childhood and adult cumulative trauma as predictors of symptom complexity. Journal of Traumatic Stress, 2009. 22(5) : p. 399-408.
34 Herman, J., D. Kallivayalil, and Victims of Violence Program, Group trauma treatment in early recovery : promoting safety and self-care. 2019, New York : The Guilford Press.
35 Purtle, J., Systematic Review of Evaluations of Trauma-Informed Organizational Interventions That Include Staff Trainings. Trauma, Violence, & Abuse, 2018. 21(4) : p. 725-740.
36 Wang, L., et al., Psychological First Aid Training : A Scoping Review of Its Application, Outcomes and Implementation. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021. 18(9) : p. 4594.
37 Sprang, G., F. Lei, and H. Bush, Can organizational efforts lead to less secondary traumatic stress ? A longitudinal investigation of change. American journal of orthopsychiatry, 2021. Advance online publication.
38 Ricciardelli, R., et al., Understanding needs, breaking down barriers : examining mental health challenges and well-being of correctional staff in Ontario, Canada. Frontiers in psychology, 2020. 11.
39 Dworkin, E.R., et al., PTSD in the Year Following Sexual Assault : A Meta-Analysis of Prospective Studies. Trauma, Violence, & Abuse, 2023. 24(2) : p. 497-514.
40 Voth Schrag, R., et al., Experiencing Moral Distress Within the Intimate Partner Violence & Sexual Assault Workforce. Journal of Family Violence, 2023.
41 Wanamaker, K., S. Brown, and A. Czerwinsky, Abuse, neglect and witnessing violence during childhood within justice-involved samples : A meta-analysis of the prevalence and nature of gender differences and similarities. Journal of Criminal Justice, 2022. 82 : p. 101990.
42 Pasparage-Polischak, S., Women and Trauma Exposure : An Analysis of Childhood Attachment, Trauma, and the Effects on Criminal Offending. 2022, Carlow University.
43 Ko, H. and A. Memon, Secondary traumatization in criminal justice professions : a literature review. Psychology, crime & law, 2022. 29(4) : p. 361-385.
44 Regehr, C., et al., Prevalence of PTSD, depression and anxiety disorders in correctional officers : A systematic review. Corrections, 2021. 6(3) : p. 229-241.
45 Lisak, D. and S. Beszterczey, The cycle of violence : The life histories of 43 death row inmates. Psychology of Men & Masculinity, 2007. 8(2) : p. 118-128.
46 Office of the Surgeon General, The US Surgeon General’s Framework for Workplace Mental Health & Well-Being. 2022.
47 Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Trauma Training for Criminal Justice Professionals. 2020 [cited 2021 13-08-2021]; Available from : https ://www.samhsa.gov/gains-center/trauma-training-criminal-justice-professionals.
48 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Trauma-informed care in behavioral health services. Treatment improvement protocol (TIP), in Series 57. 2014 : Rockville, MD : Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
49 Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA’s concept of trauma and guidance for a trauma-informed approach. HHS Publication No. (SMA) 14-4884. 2014.
50 Richardson, M., T. Big Eagle, and S. Waters, A systematic review of trauma intervention adaptations for indigenous caregivers and children : Insights and implications for reciprocal collaboration. Psychological Trauma : Theory, Research, Practice, and Policy, 2022.