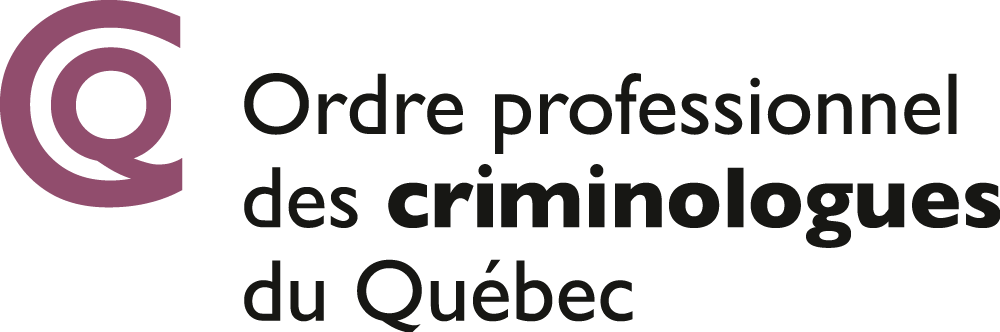Ces dernières années, il nous a été permis de constater que les droits des personnes victimes ont été de plus en plus évoqués dans l’espace public et politique, devenant une des priorités affichées du gouvernement actuel. Bien que cette visibilité accrue puisse laisser croire que ces droits ont toujours existé, sont pleinement reconnus et sont effectifs, de nombreux défis persistent.
Historiquement, les préoccupations entourant les droits des personnes victimes d’infractions criminelles ainsi que leurs proches sont récentes. En effet, initialement la recherche se concentrait principalement sur le rôle que la personne victime avait dans sa propre victimisation, ou encore sur la relation entre celle-ci et la personne délinquante. Dans le courant des années 1970, les mouvements féministes au Québec ont amorcé la lutte et la dénonciation des violences faites aux femmes et aux enfants. C’est avant tout sous l’angle de l’accessibilité aux services que les différents acteurs s’étant mobilisés ont amorcé leur réflexion et leurs actions, menant ainsi à la mise en place des premières maisons d’hébergement et centres de crise.
Malgré l’adoption, en 1972, de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, ce n’est qu’au début des années 1980 que l’on s’intéresse aux droits des personnes victimes d’infractions criminelles, grâce à la mobilisation de plusieurs personnes mettant en lumière les difficultés vécues et dénoncées par les personnes victimes vis-à-vis des différents acteurs du milieu judiciaire ainsi que du système de justice pénale en lui-même. C’est donc dans ce contexte que madame Micheline Baril — l’une des pionnières de la victimologie au Québec et membre fondateur du Comité d’assistance aux victimes, qui deviendra plus tard l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes (AQPV) — s’est entourée de nombreux partenaires. Ensemble, ils ont oeuvré pour donner une voix aux personnes victimes, leur offrir un espace pour qu’elles puissent enfin être entendues, après avoir été trop longtemps maintenues dans le silence.
Depuis un peu plus de 50 ans, d’importantes réformes législatives, tant au Canada qu’au Québec, ont contribué à l’évolution des droits des personnes victimes, permettant d’humaniser progressivement la réponse du système judiciaire vis-à-vis de leurs besoins.
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, mentionnée précédemment, entrée en vigueur en 1972, est l’une des premières réponses institutionnelles significatives visant à soutenir les personnes victimes d’infractions criminelles au Québec, leur permettant d’accéder à certaines indemnités pour couvrir les frais engendrés par les conséquences d’une infraction criminelle. Les enjeux financiers rencontrés par une personne victime à la suite d’une infraction criminelle sont non-négligeables et peuvent considérablement compromettre son rétablissement. Considérons seulement la perte de revenu liée à des absences au travail, les frais inhérents à certains services médicaux, à un déménagement ou encore les consultations psychologiques, pour ne citer que quelques exemples.
Au-delà de l’aspect financier, l’objectif est d’assurer un réel accès à des services, tels que des soins médicaux et psychologiques, et à un soutien adapté et essentiel, pouvant être inaccessibles en raison des coûts.
Bien qu’encore imparfaite, cette loi a été modifiée une première fois en 2013, puis a fait l’objet d’une réforme majeure, entrée en vigueur en 2021. Elle devient la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement et parmi ses diverses dispositions elle prévoit, entre autres, un élargissement de la notion de « victime » ainsi qu’un allongement du délai pour soumettre une demande d’indemnisation.
Parallèlement, le droit à la participation active des personnes victimes dans le processus judiciaire a été renforcé notamment grâce au projet de loi C-89 (1988), modifiant le Code criminel, qui introduit notamment la Déclaration de la victime, et permet à une personne victime de lire sa déclaration devant le tribunal au moment de la détermination de la peine. Plaidoyer Victimes a joué un rôle central dans l’implantation et la promotion de cette mesure au Québec, laquelle permet aux personnes victimes de s’exprimer quant aux conséquences physiques, psychologiques, sociales, financières ou autres, découlant de l’infraction criminelle subie. Plus concrètement, elle permet une participation plus active de la personne victime dans un processus judiciaire qui peut souvent s’avérer long, complexe et exigeant. Elle constitue une occasion formelle pour la personne victime de prendre la parole et de partager librement et en toute légitimité ce qu’elle a personnellement vécu. Au-delà des seuls faits liés à l’infraction criminelle, qu’en est-il de la personne directement touchée par ces événements ? Ce droit, dorénavant reconnu, permet non seulement de répondre à différents besoins, mais contribue aussi, pour bien des personnes victimes, à une véritable reprise de pouvoir sur leur récit.
Bien que plusieurs autres avancées législatives aient contribué à faire progresser les droits des personnes victimes, ce n’est qu’en 2015 qu’un instrument juridique spécifique a été adopté, soit la Charte canadienne des droits des victimes. L’adoption de cet instrument constitue un tournant important dans la reconnaissance formelle de quatre droits fondamentaux pour les personnes victimes — le droit à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement — dans le cadre des procédures pénales. Ce texte de loi prévoit également des recours lorsque ces droits reconnus ne sont pas respectés. Véritable levier pour l’avancement des droits des personnes victimes, la Charte a permis de modifier plusieurs dispositions dans le Code criminel et autres législations. Toutefois, elle présente des limites : elle ne s’applique que dans le cadre des procédures pénales, elle ne crée pas de droits autonomes et n’a pas de force exécutoire. En effet, bien qu’elle prévoie un mécanisme d’examen des plaintes dans le cas où ces droits ne sont pas respectés, aucun mécanisme exécutoire de résolution des différends n’est prévu pour les personnes victimes insatisfaites du traitement de leur plainte, ce qui rend ces recours peu efficaces.
Ainsi, comme le souligne le rapport annuel de 2019-2020 sur le Mécanisme des plaintes liées à la Charte canadienne des droits des victimes :
Cette Charte vise à reconnaître et à protéger les droits des victimes à toutes les étapes du processus de justice pénale, en réaffirmant leurs droits à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement. Cependant, malgré près de dix ans d’application, la situation des victimes n’a pas beaucoup évolué. En 2019, le ministère de la Justice du Canada a reconnu que de nombreuses victimes restent désillusionnées et déçues par le système de justice pénale, et que le taux de dénonciation des crimes continue de baisser. La méfiance envers le système de justice pénale demeure élevée, notamment pour les crimes comme les violences sexuelles.
Par conséquent, malgré les avancées notables de ces dernières décennies pour la reconnaissance des droits des personnes victimes, la pleine réalisation de ces droits reste une préoccupation constante. Il demeure impératif de poursuivre les efforts pour garantir un véritable accès à la justice et un soutien adéquat aux personnes victimes. C’est un engagement que Plaidoyer Victimes et ses partenaires sont prêts à honorer, car il est essentiel pour garantir la reconnaissance, le respect et l’effectivité des droits de toutes les personnes victimes.
1. Pour en savoir plus sur la Charte canadienne des droits des victimes, voir la brochure de Plaidoyer Victimes disponible en ligne https://aqpv.ca/wp-content/uploads/ ccdv_brochure_2018.pdf ou l’affiche disponible en ligne https://aqpv.ca/ boutique/charte canadienne-desdroits- des-victimes-affiche/ (ou lien bitly ?)
2. Ministère de la Justice du Canada, Rapport annuel 2019-2020 sur le Mécanisme de traitement des plaintes liées à la Charte canadienne des droits des victimes, 2019, https://justice.canada.ca/fra/pr-rp/ jp-cj/victim/mtpccdv-cvbrcm/20/ index.html.