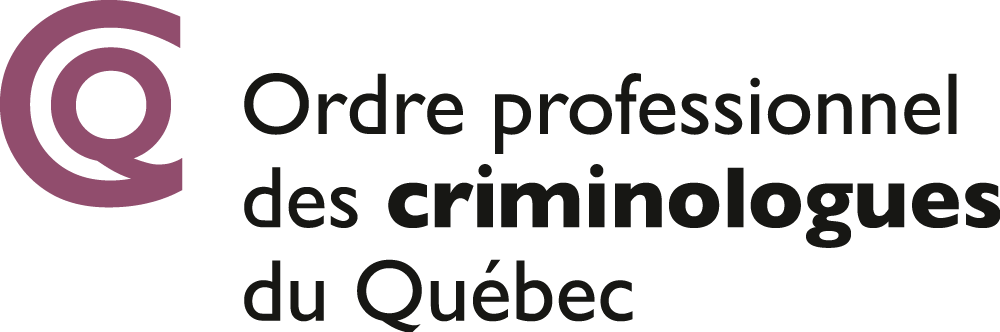Depuis plus de quatre ans maintenant, j’ai le privilège d’être chargée de cours à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et de donner notamment le cours portant sur les enjeux éthiques en criminologie. J’y aborde entre autres la notion de « comment faire pour bien faire » dans des situations complexes. Des situations qui amènent des dilemmes d’action, « faire ou ne pas faire » où, comme professionnel, on cherche un sens à donner à nos interventions pour arriver à la meilleure décision possible ou parfois, à la moins mauvaise d’entre elles. Cette quête de sens s’appuie notamment sur nos valeurs, nos principes, nos croyances et nos expériences.
Quels sont les facteurs qui influencent la prise de décision ? Quelles sont les valeurs au cœur de l’intervention en criminologie ? Comment faire le bien et minimalement ne pas nuire ? Comment réguler nos comportements en tant que criminologues pour que nos interventions soient prévisibles, sécuritaires et respectent les normes et les valeurs de la profession ? Comment prendre une décision juste et raisonnable dans des circonstances particulières ?
Ce billet, évidemment, ne cherche pas à répondre à toutes ces grandes questions, mais s’inscrit dans une volonté de donner quelques éléments de réponse aux membres et aux candidats à la profession, en mettant en avant certains éléments normatifs incontournables et leurs valeurs sous-jacentes.
La confidentialité et le secret professionnel
Ces concepts sont au cœur de nombreuses questions des membres et futurs candidats à la profession. Sans reprendre tout ce que nous avons déjà écrit dans l’avis professionnel rédigé sur ce sujet, il est intéressant de se rappeler que ces deux concepts ont comme dénominateur commun le respect de la vie privée, enchâssé dans la Charte des droits et libertés de la personne. C’est en cherchant à respecter ce droit fondamental des clients que toute personne impliquée dans une prestation de services doit garder confidentielles les informations obtenues. Une fois membres de leur ordre professionnel, les criminologues sont assujettis à l’obligation de respecter le secret professionnel.
La Loi est claire, nous ne pouvons divulguer les informations obtenues sous le couvert du secret professionnel ou de la confidentialité sauf si, le client nous y autorise ou si une disposition expresse de la loi nous le permet ou nous oblige à le faire. Ainsi, pour collecter, utiliser et communiquer des informations sans le consentement du client, il faut avoir la légitimité de le faire en fonction d’une disposition légale.
Il est important ici de noter que certaines informations recueillies par les criminologues ne sont pas obtenues sous le couvert du secret professionnel puisque d’emblée, elles ne sont pas partagées avec l’intention d’être gardées secrètes. De nombreux criminologues interviennent en contexte d’autorité et en situation de crise où les données recueillies ne sont pas soumises au secret professionnel. Des dispositions légales autant fédérales que provinciales permettent aux criminologues d’agir en contexte non volontaire notamment sous les lois suivantes : le Code criminel, la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la Loi sur le système correctionnel du Québec, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et la Loi sur la protection de la jeunesse.
Par ailleurs, d’autres contextes d’intervention obligent les criminologues à respecter le secret professionnel et assurent, par le fait même, une protection additionnelle à la clientèle. Pensons ici aux criminologues qui exercent auprès des personnes victimes ou auprès des personnes aux prises, entre autres, avec une problématique de dépendance, d’itinérance ou de santé mentale.
L’obligation liée au secret professionnel a des limites. Dans un souci d’en illustrer quelques-unes, je vous soumets ces exemples qui ont pour but de protéger une personne ou un groupe de personnes.
01. À la suite de l’analyse des faits au cœur d’une estimation du risque suicidaire, la valeur de sécurité associée au fait de prévenir un acte de violence, dont un suicide, sera priorisée sur la valeur du respect de la vie privée.
02. Dans un autre cas de figure, la levée du secret professionnel sera requise puisque la valeur de l’intérêt de l’enfant, mis en avant dans la Loi sur la protection de la jeunesse, aura préséance sur le respect de la vie privée.
03. Un dernier exemple voudra qu’en contexte de violence conjugale, les valeurs de sécurité et de protection des personnes concernées aient préséance sur le respect de la vie privée lorsque les faits rapportés sont tel que le déclenchement d’une cellule d’intervention rapide sera requis afin d’assurer un filet de sécurité autour des personnes victimes de violence conjugale, de leurs enfants et de leur conjoint ou ex-conjoint, et ce, afin de prévenir les homicides conjugaux.
04. Dans tous les cas, le criminologue est dans l’obligation d’exercer son jugement professionnel en considérant notamment les facteurs de risque, les facteurs de protection ainsi que les lois applicables.
Je vous invite à lire l’avis professionnel : La confidentialité et le secret professionnel : comment naviguer avec assurance ? qui deviendra sans aucun doute un document de référence important pour les criminologues. Cet avis a été rédigé par Mmes Martine Hugron, Michelle Dionne et Geneviève Lefebvre, criminologues et Me Geneviève Roy, avocate.
Obtenir le consentement… un acte réfléchi qui encadre la pratique professionnelle
Dans le contexte professionnel au Québec, le consentement éclairé revêt une importance cruciale dans les interactions entre les professionnels et les individus qu’ils servent. Que ce soit dans le domaine médical, juridique, psychologique ou criminologique, le consentement éclairé est un principe fondamental qui garantit le respect des droits et de la dignité des personnes.
Le principe fondamental de respect de la vie privée est de nouveau mis de l’avant ici lorsque, comme professionnels, nous cherchons à obtenir des informations de notre client, de ses proches ou d’un tiers. La Loi exige que les informations collectées respectent premièrement le critère de nécessité qui a pour objectif de réduire les atteintes à la vie privée des personnes concernées. Ainsi, obtenir des informations non pertinentes à notre mandat ou consulter des dossiers sans avoir la légitimité de le faire sont des manquements professionnels.
De plus, tous les professionnels doivent respecter les critères de validité du consentement qui peuvent être énumérés comme suit : manifeste, libre, éclairé, donné à des fins spécifiques, valide pour la durée nécessaire à la réalisation du but poursuivi, granulaire (demandé pour chaque fin spécifique), compréhensible et distinct.
Le respect de l’autonomie de la personne est également une valeur au cœur de ce concept. La Loi prévoit que le client doit exercer un contrôle sur la collecte, l’utilisation et la circulation des informations qui le concernent. Ainsi, le client doit pouvoir choisir, en toute connaissance de cause, de révéler ou de ne pas révéler certaines informations en fonction du mandat confié au criminologue devant lui.
Les professionnels doivent également tenir compte du niveau de vulnérabilité et de compréhension des individus, en particulier lorsqu’ils sont confrontés à des situations de crise et de détresse. Ils doivent s’assurer que les personnes concernées sont en mesure de comprendre les informations fournies.
Le consentement éclairé est un principe essentiel de la pratique des criminologues, même en contexte non volontaire, garantissant le respect des droits, de l’autonomie et de la dignité des individus.
Je vous invite à lire l’avis professionnel rédigé par Me Geneviève Roy sur ce sujet : Des actions à prendre pour les criminologues en pratique privée en lien avec la Loi 25.
La posture professionnelle… un pilier de confiance et d’intégrité
En tant que criminologues, nous sommes investis d’une responsabilité dans la quête de justice, de sécurité et de réhabilitation au sein de nos communautés. Notre posture professionnelle, caractérisée par nos attitudes, nos comportements et nos valeurs, revêt une importance capitale dans l’exercice de nos fonctions et dans la manière dont nous sommes perçus par le public et par nos pairs.
Cette posture repose sur des principes d’éthique, d’intégrité, de compétence, de respect et de responsabilité sociale. En adoptant une attitude professionnelle exemplaire, nous contribuons à renforcer la confiance du public dans notre profession.
Éviter tout comportement qui pourrait porter atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession, en tout temps et en tout lieu, fait partie des devoirs des professionnels du Québec. Dit autrement, le criminologue doit non seulement être digne de confiance, mais il doit aussi inspirer la confiance.
Je vous invite à lire l’avis professionnel rédigé par Me Geneviève Roy : Obligations déontologiques des criminologues relatives aux publications sur les réseaux sociaux, notamment sur l’application OnlyFans.
En conclusion, sans prétendre répondre à toutes les situations complexes qu’un criminologue peut vivre dans sa pratique, les éléments évoqués dans cet article et dans les avis professionnels de l’OPCQ sont un point d’ancrage pour réfléchir à l’action à prendre dans une situation donnée. En suivant ces principes et ces valeurs, les professionnels contribuent à maintenir une relation de confiance avec le public, leurs pairs et leurs clients.
Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture de ce Beccaria et des avis professionnels. L’OPCQ cherche à soutenir ses membres dans l’exercice de leurs fonctions alors n’hésitez pas à nous faire part de vos questionnements, de vos enjeux et de vos bons coups. Ensemble, on est assurément plus fort et plus pertinent.
Geneviève Lefebvre, criminologue
Directrice générale et secrétaire